 environnementale des chantiers.
environnementale des chantiers.Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Bâtir dans le respect de
l'environnement et répondre aux besoins présents sans compromettre ceux des générations
futures, tels sont nos engagements. Depuis plusieurs années, la politique menée
par la Fédération Française du Bâtiment vise à satisfaire les nouvelles
demandes des clients, tout en valorisant le savoir-faire des entreprises. Elle
consiste aussi à améliorer la qualité environnementale des chantiers.
environnementale des chantiers.
Vous trouverez au travers du bilan ci-après les enjeux propres à notre activité . Vous constaterez que des progrès importants ont été réalisés en faveur de l'environnement, mais nous ne devons pas en rester là. Bâtir l'environnement, c'est un travail de tous les jours... une oeuvre de longue haleine dont chacun sortira gagnant.
Alain Sionneau Président de la Fédération Française du Bâtiment
Les Enjeux
![]()
Cadre
de vie et paysage bâti
Préservation, réhabilitation, démolition, construction permettent aux villes, villages et quartiers de conserver leur identité, de se régénérer et ainsi de continuer à répondre aux attentes de leurs habitants et de leurs visiteurs.
Entretenir et mettre en valeur les bâtiments ordinaires
Une enquête réalisée fin 1997 par la Fédération Française du Bâtiment auprès des communes de France a révélé que:
Le nombre des édifices protégés est supérieur à 36 000 : 23 000 sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques et des Richesses Artistiques et 13 000 classés Monuments Historiques.
Ce patrimoine n'est pas seulement constitué de bâtiments prestigieux. Il existe également partout en France, un grand nombre d'édifices, témoignages plus modestes du passé (chapelles, fontaines, lavoirs, fours, halles, ...) qu'il convient de préserver, car ils font partie de la culture et de la tradition locales.
Constitué en 1959 sous l'égide de la Fédération Française du Bâtiment, le Groupement National des Entreprises de Restauration des Monuments Historiques réunit les entreprises de toutes tailles soucieuses de la transmission d'un "savoir-faire" pour intervenir sur les édifices publics ou privés et en assurer la sauvegarde. Titulaires d'une qualification de très haute technicité, ces entreprises sont aptes à assurer l'exécution des travaux dans le respect des techniques anciennes de construction. Onze qualifications sont attachées à ces entreprises. Elles regroupent Tailleurs de pierre, les Maçons, les Charpentiers, les Couvreurs, les Menuisiers et les Maîtres Verriers.Plus de 1400 opérations de restauration, de mise en valeur d'édifices classés ou de patrimoine plus ordinaire ont été entreprises depuis 1995, sous l'impulsion du concours " les Rubans du Patrimoine ".
Les thèmes abordés: centres villes, mairies et équipements scolaires, bâtiments du patrimoine, bâtiments du patrimoine et bâtiments du patrimoine industriel, bâtiments du patrimoine et bâtiments du patrimoine du XXe siècle
![]()
Bien être
dans les constructions
Choix des matériaux, diversité des volumes, performances croissantes des équipements techniques sont autant d'atouts qui conduisent à la maîtrise d'ambiances favorables au bien-être dans les constructions.
Parallèlement, ces dernières années, différentes crises à l'échelle nationale ou internationale, ont favorisé le développement de véritables peurs parmi nos concitoyens à l'égard de leur environnement immédiat.
Touché par les problèmes de l'amiante, le bâtiment n'échappe pas à ce phénomène. Paradoxalement, des risques avérés semblent ignorés des populations.
Face à- ce constat, les entreprises du bâtiment, toujours à l'écoute des attentes des occupants, entendent favoriser le dialogue avec les professionnels de la santé et les industriels de la construction .
Améliorer le confort
Même si en vingt ans le taux de résidences avec chauffage central a progressé de 32 %, près de 15 % des résidences principales n'ont toujours pas de chauffage central
Les excès de froid ou de chaleur, en déclenchant dans le corps humain certains mécanismes régulateurs, entraînent une diminution des capacités physiques et intellectuelles: maladies, maux de tête, difficultés de sommeil. . .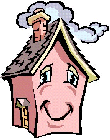
Afin de soustraire l'homme à ces différents maux et lui permettre d'accéder à plus de bien-être, des progrès considérables ont été accomplis dans les notions de qualité des ambiances. L'adaptation des conditions ambiantes de température et d'hygrométrie, à la physiologie de l'occupant en fonction de l'activité, des saisons, des périodes diurnes et nocturnes par le chauffage ou la climatisation, est un élément incontestable des progrès en terme de confort.
Parallèlement, le niveau d'exigences s'est élevé et porte sur des domaines de plus en plus étendus tels que l'éclairement, I'isolement acoustique, la pureté de l'air ou la faculté de pouvoir communiquer.
Mais des progrès sont encore possibles.Trop de bâtiments sont encore aujourd'hui insalubres, pas ou mal ventilés ou soumis à des intensités de bruits telles quelles risquent d'altérer la santé de leurs occupants.
Rendre les Bâtiments plus sains
- Améliorer la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments La
qualité de l'air à l'intérieur d'un bâtiment résulte à la fois de la pénétration
des polluants extérieurs, de l'émission de polluants due à l'occupation des
locaux et de la qualité de la ventilation. Certains matériaux qui réagissent
à la température, l'humidité ou les rayonnements solaires peuvent contribuer
à cette pollution.
La
qualité de l'air à l'intérieur d'un bâtiment résulte à la fois de la pénétration
des polluants extérieurs, de l'émission de polluants due à l'occupation des
locaux et de la qualité de la ventilation. Certains matériaux qui réagissent
à la température, l'humidité ou les rayonnements solaires peuvent contribuer
à cette pollution.
Composé essentiellement d'azote (78 %), d'oxygène (20 %) et de gaz rares, l'air conditionne la quasi-totalité des formes de la vie terrestre. Toute modification dans la composition de l'air que l'homme respire a une répercussion sur sa santé.
L'amélioration de la ventilation des bâtiments est le facteur le plus immédiat pour obtenir des résultats dans ce domaine. Associée à la maintenance des équipements de gestion de l'air, la filtration de l'air permet de limiter la pénétration des polluants extérieurs tels que poussières ou pollens.
- Bien choisir les matériauxLes entreprises sont de plus en plus vigilantes lorsqu'elles choisissent des produits de finitions de surfaces ou de traitements des matériaux. Les critères de sélection sont relatifs d'une part aux problèmes liés à la mise en œuvre et d'autre part, aux conséquences potentielles sur l'usager.
- Améliorer l'isolement acoustique des bâtimentsDes études réalisées sur le sommeil indiquent que des bruits de crête de 60 à 65 dB(A) provoquent des perturbations du rythme cardiaque et de la vasectomie sans pour autant réveiller le dormeur.
Les professionnels du Bâtiment ont un rôle de conseil pour éviter une dégradation du confort acoustique. Ils sont en mesure de proposer des solutions pour améliorer l'isolement acoustique des bâtiments existants. La mise en oeuvre de ces solutions par des entreprises qualifiées doit être précédée d'un diagnostic.Réduire les risques
- Enrayer les intoxications dues au monoxyde de carbone :
Les phénomènes de production du monoxyde de carbone sont parfaitement connus: ce gaz inodore et incolore résulte de la combustion incomplète de substances organiques carbonées telles que le gaz ou le bois .
La première cause de formation de monoxyde de carbone est l'obstruction du conduit de fumée par des suies ou des gravats. Les autres causes recensées sont les conduits de fumée non réglementaires ou insuffisamment isolés et les défauts de ventilation du local .
Le ramonage annuel des conduits de fumée et la vérification régulière des conditions de ventilation du local par des entreprises qualifiées, permettent de réduire considérablement les risques d'intoxication au monoxyde de carbone.
- Supprimer tout risque de contamination par le plomb85 000 enfants de un à six ans ont dans le sang un taux de plomb deux fois supérieur à la normale - Source AFP 13 janvier 1999
C'est pour les jeunes enfants que les risques encourus par les intoxications au plomb sont les plus graves. Outre les teneurs en plomb dans l'eau de boisson, I'autre source de contamination par le plomb se trouve dans la céruse, interdite depuis 1948, et dans certaines peintures aux sulfates de plomb interdites dans le secteur du bâtiment depuis 1993.
Les entreprises maîtrisent les différentes solutions techniques et les méthodologies à appliquer pour supprimer ces risques d'intoxication par le plomb.
Une large diffusion de guides renseignant sur ces techniques et sur l'organisation des chantiers a été réalisée auprès des professionnels dès 1997.
- Supprimer l'amianteLa surface totale estimée de flocages et
calorifugeages amiantés en France est comprise entre 4,5 et 7 millions de m2.
La moitié de cette quantité soit environ 2,5 millions de m2 nécessite une
intervention. 
L'amiante est un matériau minerai naturel fibreux, qui a été utilisé principalement pour sa résistance exceptionnelle aux hautes températures et à la corrosion. C'est la dispersion des fibres d'amiante dans l'air qui crée une menace pour la santé.
Les professionnels ont participé à l'élaboration d'un système de qualification avec référentiel spécifique pour le retrait, la dépose ou le confinement de matériaux friables contenant de l'amiante. Actuellement, plus d'une centaine d'entreprises ont acquis cette qualification indispensable à la réalisation de ces travaux.Le Groupement National Amiante de la Fédération Française du Bâtiment a réalisé, début 1999, le guide " AMIANTE " qui résume tout ce que doit connaître l'entreprise qui intervient sur un site susceptible de contenir de l'amiante.
- Diminuer la présence de radon dans les bâtimentsSur le territoire français, on estime à 300 000
le nombre d'habitations individuelles où la concentration de radon est supérieure
à 400 Bq/m3 et à 60 000 celles où elle est supérieure à 1 000 Bq/m3.
Le radon constitue la seconde cause d'exposition aux rayons ionisants, la première cause étant les expositions médicales.
Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle présent partout à la surface de la planète. Facteur de risque de cancer du poumon, sa concentration dans notre environnement est très variable.
La réduction de la teneur en radon à l'intérieur des constructions est possible. Les techniques mises en œuvre par les entreprises du bâtiment, réduisent la pénétration du radon à l'intérieur du bâtiment et favorisent son évacuation vers l'extérieur. L'efficacité de la mise en œuvre est contrôlée par des mesures réalisées avant et après intervention.
20 000 plaquettes d'informations pratiques destinées aux professionnels du bâtiment ont été diffusées à travers la France en 1999.
- Réduire les risques d'accidents domestiques
Les accidents domestiques représentent un coût total de 20 milliards de francs par an pour la Sécurité Sociale.
Les accidents domestiques provoqueraient chaque année en France de 12 à 25 000 décès. Une enquête réalisée par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie en 1990 a révélé que les accidents domestiques sont trois fois plus nombreux que les accidents du travail et dix fois plus nombreux que les accidents de la route.Les professionnels du bâtiment se sentent concernés par certains risques tels que les brûlures, les chutes, les chocs. Ils participent à l'amélioration de la prévention en proposant des matériels mieux adaptés à l'usage tels que des mitigeurs thermostatiques pour empêcher les brûlures par l'eau chaude sanitaire ou les entrebailleurs pour éviter les chutes par défenestration.
Gestion des ressources naturelles
 Afin de s'insérer dans un schéma de développement
durable, il devient essentiel de minimiser les prélèvements sur les ressources
naturelles non renouvelables, de promouvoir le développement des ressources
renouvelables, de limiter les rejets lors des différentes transformations des
matériaux en produits finis et de s'interroger sur le devenir en fin de vie des
matériaux et composants.
Afin de s'insérer dans un schéma de développement
durable, il devient essentiel de minimiser les prélèvements sur les ressources
naturelles non renouvelables, de promouvoir le développement des ressources
renouvelables, de limiter les rejets lors des différentes transformations des
matériaux en produits finis et de s'interroger sur le devenir en fin de vie des
matériaux et composants.
Chaque année, la filière construction consomme, en France:
Prendre en compte les caractéristiques environnementales des matériaux
Jusqu'à maintenant, les matériaux étaient essentiellement choisis en fonction de leurs performances techniques, des coûts liés à leur fabrication et à leur mise en œuvre, et de leurs qualités esthétiques.
Désormais, il faudra également se préoccuper de leurs impacts environnementaux.
Afin de pouvoir établir un critère de sélection qui se rapporte à l'ensemble des qualités d'un matériau, produit ou composant, les entreprises du bâtiment soutiennent le principe d'un affichage de leurs caractéristiques environnementales.
Cet affichage renseignera notamment sur l'énergie nécessaire à leur élaboration, sur leur durée de vie ainsi que sur les modes d'élimination qui leur sont applicables en fin de vie.II doit en outre, informer précisément de la présence éventuelle de substances toxiques et de leur mode d'émission, ceci afin de préserver la santé des usagers mais aussi celle des ouvriers qui mettent en œuvre ces matériaux.
Réduire les pertes lors de la mise en oeuvre
Les entreprises du bâtiment sont soucieuses de minimiser ces pertes qui engendrent également des perturbations sur le voisinage lors de leur évacuation. Le calepinage permet d'économiser entre 15 et 20 % des matières mises en œuvre sur un chantier.
Un logiciel d'optimisation lors de la mise en œuvre des cloisons et doublages est d'ores et déjà utilisé par les plâtriers. Recycler les déchets de constructionPrès de 3 millions de tonnes de déchets matières
sont générés chaque année, en France lors de la mise en œuvre sur chantier
Recycler les déchets issus de la construction nécessite de mettre en place une véritable politique de gestion de ces déchets. Pour ce faire, les entreprises du bâtiment installent progressivement sur l'ensemble du territoire des plates-formes de regroupement des déchets de chantier, qui permettent d'entreposer provisoirement des petites quantités de déchets du bâtiment amenées par les professionnels.
Elles mettent également en place des plates-formes de regroupement, de tri et de prétraitement des déchets. Ces plates-formes sont essentiellement axées vers la valorisation et le recyclage des déchets, le prétraitement devant permettre le renvoi des matériaux vers les filières industrielles dont ils sont issus.
- Le plâtreD'ores et déjà, les chutes de fabrication du plâtres sont réintroduites dans le cycle de fabrication de nouveaux produits grâce aux ateliers de recyclage associés aux sites de production.
Sur chantier, le recyclage des déchets de plâtre et de polystyrène expansé a été validé lors d'opérations expérimentales Cette valorisation matière, qui a permis la fabrication de produits similaires à ceux fabriqués initialement a nécessité un tri rigoureux pendant la phase chantier.
A l'instigation de la Fédération Française du Bâtiment, des recherches réalisées en laboratoire ont permis de mettre au point l'élaboration d'un nouveau matériau à partir des déchets de chantier contenant du plâtre en mélange avec du béton ou de la brique. Les blocs ainsi obtenus ont des performances mécaniques excédant largement celles des matériaux en plâtre traditionnel.
- Les granulatsSeuls les déchets minéraux des produits de démolition des bâtiments peuvent servir de matières premières aux granulats de recyclage. Le potentiel de matériaux recyclables issus du bâtiment est estimé entre 10 et 15 millions de tonnes par an.
Les 6 millions de tonnes de granulats recyclés annuellement, proviennent pour une grande part des travaux publics. Pour que ce recyclage se développe, il est nécessaire que les maîtres d'ouvrage permettent l'utilisation de ces matériaux dans leurs appels d'offre et que les fournisseurs s'engagent sur le respect des critères de qualité.
- Les peinturesLes déchets de peinture venant des entreprises, représentent 5 500 tonnes pour les résidus avec solvant organique et 6 100 tonnes pour les résidus avec solvant aqueux
II est à noter que l'estimation relative à ce même type de déchets provenant des particuliers se situe entre 4 500 tonnes et 9 000 tonnes pour les résidus avec solvant organique et entre 4 000 tonnes et 8 300 tonnes pour les résidus avec solvant aqueux.
Des études sur la valorisation des déchets de peinture sont menées en laboratoire. A partir des plates-formes de regroupement, de tri et de prétraitement des déchets de chantier et d'unités mobiles, il est possible de séparer les différents constituants présents dans les résidus de peinture. Après traitement, deux types décomposés, extraits secs et solvants sont valorisables. Les extraits secs sont réutilisables en tant que matière première pour la formulation de peintures de qualité inférieure.
![]()
 Les
principales pollutions atmosphériques liées à l'activité humaine génèrent
trois impacts environnementaux pour la planète : un réchauffement dû à
l'augmentation de l'effet de serre, l'altération de la couche d'ozone et ses
conséquences sur la diminution de la protection de l'homme vis à vis des
rayonnements solaires et les pluies acides et leurs conséquences sur le sol et
les forêts.
Les
principales pollutions atmosphériques liées à l'activité humaine génèrent
trois impacts environnementaux pour la planète : un réchauffement dû à
l'augmentation de l'effet de serre, l'altération de la couche d'ozone et ses
conséquences sur la diminution de la protection de l'homme vis à vis des
rayonnements solaires et les pluies acides et leurs conséquences sur le sol et
les forêts.
L'effet de serre est dû principalement à l'émission des gaz suivants: le gaz carbonique, le méthane, le protoxyde d'azote et certains composés halogénés.
L'altération de la couche d'ozone résulte principalement de l'émission de certains gaz frigorigènes (tels les chlorofluorocarbures).
Les pluies acides sont dues principalement à la production de dioxyde de soufre et d'oxydes d'azote.
Comme d'autres secteurs industriels, le Bâtiment est concerné par ces enjeux et s'est engagé pour trouver des solutions pérennes à ces questions.
Contribuer à la réduction de l'effet de serreEn France, le secteur du bâtiment consomme près de 45% de l'énergie finale et produit 30 % des émissions de gaz carbonique, à travers plusieurs types d'usage: le chauffage, la climatisation, I'eau chaude sanitaire, les appareils domestiques et l'éclairage.
Par le potentiel d'économies d'énergie mobilisable, par la diversité des approvisionnements énergétiques utilisables, selon ces différents types d'usage et par l'utilisation de matériaux stockant le gaz carbonique, le Bâtiment peut contribuer de manière significative à la réduction de l'effet de serre.
La recherche d'une maîtrise accrue des
consommations d'énergie dans le secteur du bâtiment est une des priorités de
la Fédération Française du Bâtiment. Participant activement à l'élaboration
ou à la modification des textes législatifs, la Fédération Française du Bâtiment
contribue à mettre en œuvre sur le terrain les politiques en matière de maîtrise
des consommations d'énergie dans ce secteur.
La mise en œuvre par les entreprises du bâtiment des nouvelles dispositions découlant de la réglementation thermique de 1989, a permis de diviser par deux les consommations par m2 pour le chauffage des résidences principales construites depuis cette date.
Les maisons avec chauffage central construites avant 1975 représentent 35 % de la consommation du secteur habitat.
En s'appuyant sur l'analyse des Consommations d'énergies des bâtiments existants et en projetant le mise en œuvre de nouvelles technologies, il est possible d'affirmer que de nombreux progrès sont encore réalisables.
En ce qui concerne les bâtiments neufs, des améliorations sont encore possibles surtout dans le bâtiments hors logements.
Mobiliser les économies d'énergieSur les 23 millions de logements constituant le parc global, seuls 7 millions ont été construits en respectant la réglementation mise en place en 1974 et 2,5 millions d'entre eux respectent la réglementation de 1989.
En ramenant les performances énergétiques des maisons avec chauffage central construites avant 1975 à celles construites après cette date, on obtiendra une économie d'énergie d'au moins 30 %.
Le secteur tertiaire est encore plus disparate puisqu'il regroupe, entre autre, des commerces, des bâtiment d'enseignement ou des bureaux. Les consommation énergétiques de ce secteur sont, actuellement, nettement supérieures à celles du secteur de l'habitat. En résumé, I'état énergétique du parc construit est mal connu, autant en ce qui concerne les déperdition des bâtiments que l'efficacité des équipements énergétiques.
- Connaître avant d'agir
Améliorer les performances énergétiques d'un bâtiment existant nécessite de rechercher ses faiblesse et ses points forts au travers d'un diagnostic détaillé.
L'analyse de ce diagnostic permet de proposer les meilleures réponses en terme d'efficacité énergétique et de confort pour les occupants de ce bâtiment.
- Isoler les bâtiments existants et gérer la
ventilation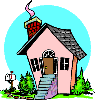
Réduire les déperditions au niveau de l'enveloppe par une meilleure isolation thermique des parois opaques ou vitrées permet d'agir directement sur les besoins énergétiques. Mais, afin de garantir une qualité de l'air intérieur satisfaisante, toute opération d'isolation des façades doit S'accompagner d'un contrôle du système de ventilation et peut nécessiter parfois la mise en place d'un système spécifique de gestion de l'air.
- Optimiser les équipements
La maîtrise de la consommation énergétique d'un bâtiment exige un suivi et un entretien rigoureux de ses installations de chauffage, de ventilation ou de climatisation. Les contrats d'entretien des installations du génie climatique constituent la première étape de cette maîtrise. Le maintien ou l'amélioration du rendement énergétique de ces installations par des matériels plus performants sont les garants d'une meilleure maîtrise de l'énergie.
Les résultats d'un diagnostic étendu aux consommations électriques peuvent mettre en évidence la rentabilité de la mise en œuvre d'un système de gestion intelligente de l'électricité.
- Construire des bâtiments économesDans le domaine des constructions neuves, la Fédération Française du Bâtiment est favorable à l'affichage des consommations d'énergie et à la réversibilité des modes de chauffage. Cette dernière mesure permettrait de diversifier les choix énergétiques et notamment de mieux prendre en compte l'évolution des potentialités du site d'une construction existante et des besoins des usagers.
Actuellement, la Fédération Française du Bâtiment participe à la mise au point de deux textes législatifs fondamentaux pour la maîtrise des consommations énergétiques dans le domaine du bâtiment:
- la nouvelle réglementation thermique dans le bâtiment qui s'inscrit dans le programme français de lutte contre l'effet de serre. (Elle s'appliquera aux constructions résidentielles ou non résidentielles, et devrait répondre à des exigences de confort d'été).
- les décrets d'application de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 30 décembre 1996.
- Développer l'utilisation des énergies renouvelables
Au-delà de l'amélioration de la qualité énergétique des bâtiments, I'utilisation des énergies renouvelables pour le chauffage, la climatisation et les besoins en électricité spécifique constitue une autre voie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Un sondage récent montre que 61 % des Français considèrent comme prioritaire le développement des énergies renouvelables.
La Fédération Française du Bâtiment s'est engagée depuis de nombreuses années dans ces applications.
Différentes études ont abouti à la mise au point de technologies maîtrisables par des entreprises de toute taille, ainsi qu'au montage de formations adaptées à ces mêmes entreprises. Par exemple, deux formations itinérantes permettent aux professionnels de mettre en pratique les techniques de production d'eau chaude sanitaire par rayonnement solaire et de dimensionner, mettre en oeuvre et maintenir les planchers solaires directs.
- Développer la cogénérationLa cogénération consiste à produire simultanément de la chaleur et de l'électricité. La diminution des besoins en chaleur et l'augmentation des besoins en électricité spécifique concourent au réexamen de ces techniques. Déjà largement utilisée dans le secteur de l'industrie, la cogénération pourrait se développer dans les applications du bâtiment. Des pays comme le Japon, proposent déjà des machines de faibles puissances adaptées aux petits bâtiments collectifs.
Reconstituer la couche d'ozone
Les composés halogénés et leurs mélanges, sont largement employés dans le secteur du bâtiment, notamment comme fluides frigorigènes dans les installations frigorifiques et dans les installations de climatisation .
Pour limiter leurs impacts sur la couche d'ozone, plusieurs techniques complémentaires sont mises en place:
En partenariat avec l'ADEME, la Fédération Française du Bâtiment développe ces techniques et forme ses adhérents depuis 1993
![]()
Gérer l'eau
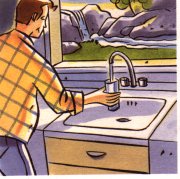
L'approvisionnement en eau d'un bâtiment nécessite que cette eau soit captée, puis transportée et finalement distribuée. Après consommation, les eaux dites usées doivent être traitées avant de pouvoir rejoindre le milieu naturel.
Les entreprises du bâtiment interviennent à plusieurs stades de la gestion de l'eau.
Elles maintiennent et améliorent les réseaux et les équipements, favorisant ainsi les économies d'eau. Elles participent au traitement des eaux usées et pourraient jouer un rôle non négligeable dans le recyclage et la récupération de l'eau.
- Économiser l'eau
Une analyse portant sur plus de 7 000 logements a montré qu'en faisant une maintenance régulière et préventive des installations et de la robinetterie, les consommations pouvaient baisser de 20 % environ. Jusqu'à 40 % de l'eau distribuée pour alimenter les WC peuvent être économisés.
Les économies d'eau dans un bâtiment nécessitent une approche globale. Chaque poste de consommation doit être étudié pour permettre d'apporter la meilleure réponse en terme d'économie et de confort pour l'usager et garantir un bon fonctionnement de l'installation.
- Traiter les eaux usées par l'assainissement autonome
10 % de la population est concernée par l'assainissement autonome et 9 % de la population ne dispose d'aucun assainissement
Condition nécessaire pour lutter contre la pollution des cours d'eau, I'assainissement peut être collectif ou individuel . L'assainissement collectif n'est pas adapté à l'habitat dispersé et coûte de plus en plus cher aux petites communes. Si les conditions techniques sont remplies, l'assainissement autonome est peut-être la meilleure solution au traitement des eaux usées pour les petites communes.
- Récupérer les eaux pluvialesLes précipitations constituent une ressource locale non négligeable. La récupération en pied d'immeuble présente le double avantage d'économiser l'eau potable et de limiter les pollutions des eaux superficielles lors des épisodes orageux.
L'eau pluviale ne peut être utilisée que pour les chasses d'eau, les machines à laver le linge, les travaux de ménage et de nettoyage, les arrosages du jardin et autres surfaces. Contrairement aux pays d'Europe du Nord, très peu d'opérations ont été réalisées en France, où la mise en place d'un système permettant l'utilisation des eaux pluviales est soumise à l'autorisation de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales.
- Récupérer les eaux usées: une voie d'avenirLes installations de recyclage des eaux usées des bâtiments sont une réalité en Allemagne, au Luxembourg et dans d'autres pays du monde. Plusieurs technologies sont capables d'épurer l'eau à l'intérieur des bâtiments afin de la recycler.
Pour une année à pluviométrie normale, une étude réalisée en 1995 pour la Fédération Francaise du Bâtiment a mis en évidence que pour les maisons individuelles, quelle que soit leur région d'implantation, leur consommation en eau non potable reste inférieure à celle qui pourrait être récupérée. Compte tenu du prix actuel de l'eau, cette technique est d'ores et déjà rentable pour des bâtiments qui ont besoin de 500 m3 I jour d'eau non potable, ce qui équivaut à 20 000 m2 de bureaux, 500 logements de 4 personnes ou un hôtel 3 étoiles de 500 chambres, situé en station balnéaire.
- Traiter les eaux pluviales Entre 1992 et 1997, les sols artificiels non bâtis ont progressé de 11,8 %.C'est parce que les eaux pluviales se chargent de matières en suspension, d'hydrocarbures, de plomb, après avoir lessivé les aires imperméabilisées des villes qu'elles deviennent des sources de pollutions pour les rivières et les cours d'eau. Lorsqu'elles sont collectées par les réseaux d'assainissement en vue de leur traitement, un afflux trop important peut être à l'origine du dépassement de la capacité de la station d'épuration, risquant d'entraîner également une pollution. Les entreprises du bâtiment peuvent mettre en œuvre localement plusieurs types de solutions.
L'exemple de la temporisation des eaux pluviales par la végétalisation.
La végétalisation des toitures terrasses inaccessibles permet de retarder les afflux d'eau vers les réseaux d'assainissement, évitant ainsi des surcharges des stations d'épuration. Améliorant l'impact visuel pour le voisinage, elle peut être réalisée sur des bâtiments neufs ou existants. Les variétés de plantes sont sélectionnées selon la région et l'aspect visuel désiré. La culture sur substrat n'occasionne pas de surcharge excessive de la toiture, même en humidité maximale.
En 1997, un CD ROM illustrant les règles professionnelles pour l'aménagement des toitures terrasses jardin en travaux neufs a été édité par la Chambre Syndicale Nationale de l'Étanchéité et l'Union Nationale des Entreprises du Paysage.
Préserver la qualité de l'eauLes eaux d'alimentation doivent garantir leur innocuité vis à vis de l'homme ou des animaux qui vont les consommer.
Des paramètres organoleptiques, physico-chimiques, microbiologiques, des paramètres mesurant la présence de substances indésirables et toxiques, sont utilisés pour définir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. On peut citer parmi ces paramètres l'odeur, la dureté, le taux de nitrates.
Des valeurs limites à ne pas dépasser sont associées à ces paramètres en vue de préserver la santé des consommateurs .
L'évolution des connaissances dans les domaines de protection de la santé peut mener à modifier des valeurs autrefois admises ou à prendre des mesures de précaution pour éviter toutes proliférations bactériennes.
Les entreprises du bâtiment sont engagées dans la lutte contre le saturnisme et la légionellose.
- Supprimer le plomb des canalisationsSi les mesures de la teneur en plomb au point de puisage indiquent des valeurs supérieures aux valeurs admises par la réglementation, un véritable diagnostic doit être fait pour interpréter les résultats et ceci avant tout démarrage de travaux. Les entreprises vont devoir rechercher les facteurs responsables, afin d'évaluer avec précision les travaux à engager pour rétablir des teneurs en plomb conformes à la réglementation.
- Empêcher le développement des " legionella "En 1997, 222 cas de légionelloses ont été officiellement déclarés, en France; on estime que ce chiffre est multiplié par un facteur 2,5 chaque année. En s'appuyant sur les données fournies par les professionnels de la santé, les entreprises spécialisées ont développé des méthodes pour empêcher les multiplications des " légionella " dans les réseaux.
Ces méthodes portent sur la désinfection des circuits d'eau chaude sanitaire qui est indispensable pour les installations n'ayant pas servi pendant une longue période. Elles concernent également l'entretien régulier des bains à remous ou à jets, et plus généralement l'entretien des réseaux d'eau chaude, notamment les circuits des aéro-réfrigérants.
L'acte de construire ne peut être réussi que si chacun des maillons qui y participe prend ses responsabilités vis à vis de l'environnement.
Cependant, il faut franchir les étapes de ce processus une à une. Pour cela, les artisans et entreprises de la Fédération Française du Bâtiment s'organisent de manière pragmatique et se dotent d'outils concrets pour faire évoluer leur savoir-faire, métiers par métiers. Un certain nombre de qualifications prennent déjà en compte cette dimension environnementale et cette démarche va se généraliser dans les années qui viennent.
Construire dans le respect de l'environnement
- Dans l'entreprise
La première étape consiste pour l'entreprise ou l'artisan, à situer son métier par rapport aux impacts environnementaux qu'il est susceptible d'engendrer. La deuxième étape vise à proposer et préférer des produits et composants qui, outre les performances techniques requises, posséderont des caractéristiques environnementales adaptées au contexte.
Au-delà des produits, c'est l'ensemble du processus de mise en œuvre qui doit évoluer au cas par cas.
Cette nouvelle dimension modifie les relations entre les entreprises et les maîtres d'ouvrage. Déjà deux chartes, liant ces deux acteurs dans le cadre d'une meilleure prise en compte de l'environnement dans les marchés, ont été signées au Havre et en Saône et Loire.
- Sur le chantierLa première préoccupation concerne l'élimination des déchets de chantiers.
L'identification de ira nature des déchets n'est pas toujours aisée. La Fédération Française du Bâtiment propose une signalétique complète des déchets pour faciliter cette reconnaissance et éviter des mélanges dans les bennes.
Les déchets ne représentent pas la seule préoccupation de la Fédération Française du Bâtiment en matière de chantiers, les autres nuisances sont elles aussi analysées afin de les réduire au maximum.
Pour aider les entreprises dans cette démarche, la Fédération Française du Bâtiment , diffuse deux guides complémentaires:
Plus de 31 millions de tonnes de déchets de chantier sont générées annuellement, représentant un coût proche de 3 % du chiffre d'affaires du bâtiment.
La principale préoccupation pour les déchets générés par l'activité démolition, concerne le non mélange. II peut être en partie résolu par l'utilisation des techniques de déconstruction. Dix opérations pilotes financées dans le cadre d'un appel à projet de l'ADEME sont en cours de réalisation.
- Les déchets de chantiers de constructions neuves.
Représentant moins de 10 % de la production totale des déchets de chantier, leur réduction n'aura qu'un impact limité.
Actuellement, une cinquantaine d'opérations pilotes visant à réduire à la source la production de ces déchets, sont en cours de réalisation. Près de la moitié d'entre elles se déroulent dans le cadre de réalisations expérimentales du Plan Urbanisme, Construction et Architecture.
A partir de l'analyse des résultats de ces opérations, la Fédération Française du Bâtiment souhaite diffuser les bonnes pratiques identifiées à l'ensemble des chantiers.
- Les déchets de chantiers de réhabilitation
Ils représentent 30 % de l'ensemble des déchets de chantiers.
Quelques opérations pilotes, réalisées lors de chantiers de réhabilitation ont montré que le non-mélange est très difficile à réaliser sur place en raison, notamment, de la diversité des composants déposés et du manque d'espace disponible. La valorisation de ce type de déchets exige le traitement sur une plateforme de tri et de regroupement extérieure au chantier.
- Les déchets de chantiers de démolition et la déconstruction
17 millions de tonnes de déchets sont générés par l'activité de démolition.
Parmi eux figurent près de 2 millions de tonnes de déchets de bois qui posent encore de nombreux problèmes d'élimination, notamment en raison des produits qu'ils contiennent. Des études sont en cours, pour trouver les conditions de combustion appropriées afin de convertir ce gisement en énergie.
L'analyse des résultats de deux opérations de déconstruction déjà terminées, a mis en évidence une amélioration de la qualité des déchets facilitant leur valorisation future, ainsi que des coûts équivalents à ceux d'une démolition classique. Mais il est important de signaler que les délais d'exécution sont beaucoup plus importants lors des chantiers de déconstruction .
- Les autres nuisances
Parmi les autres nuisances, on peut citer le bruit et la poussière. Les quelques opérations pilotes qui ont traité le problème du bruit, ont mis en avant les rôles fondamentaux de l'information et de la communication entre les acteurs du chantier et les riverains.
Informer le plus largement possible sur la destination du futur bâtiment, sur la durée du chantier, sur la durée de certaines opérations inévitablement bruyantes, telles sont les orientations de la Fédération Française du Bâtiment.
La Fédération Française du Bâtiment est particulièrement soucieuse des rejets dans l'air et dans l'eau que génèrent certaines activités liées à la démolition et à la réhabilitation.
Organiser l'élimination et la valorisation des déchets de chantierTous les efforts faits par les entreprises sur le chantier lui-même, pour récupérer et ne pas mélanger les déchets, peuvent être vains si les solutions de valorisation ou de stockage des déchets ne sont pas adaptées aux spécificités du secteur Bâtiment.
Il importe que les plans départementaux d'élimination des déchets prennent en compte nos profession.
![]()
Le guide du patrimoine (édition janvier 1999) Crédit Local de France - 7 à 9 quai André Citroën - BP 1002 - 75901 Paris cedex 15 tél.: 01 42 92 76 63 Fédération Française du Bâtiment: guide disponible auprès des Fédérations Départementales du Bâtiment
Guide de conduite des chantiers propres
SEBTP - 6-14 rue La Pérouse - 75784 Paris cedex 16 - tél.: 01 40 69 53 16
CD ROM: " Bâtir avec l'environnement )>, diffusé dans le cadre de la formation au " Guide de conduite des chantiers propres ".
Guide des déchets de chantiers de bâtiment Ademe - 27 rue Louis Vicat - 75015 Paris - tél.: 01 47 65 20 00
Signalétique des déchets de chantiers (affiches autocollantes) SEBTP - 6-14 rue La Pérouse - 75784 Paris cedex 16 - tél.: 01 40 69 53 16
Guide des déchets de chantiers de réhabilitation Ademe
Ile-de-France - 6-8 rue Jean Jaurès - 92807 Puteaux cedex - tél.: 01 49 01 45
47
Arene - 94 bis avenue de Suffren - 75015 Paris - tél. : 01 53 85 61 75
Amiante: ce que toute entreprise de bâtiment doit savoir SEBTP - 6-14 rue La Pérouse - 75784 Paris cedex 16 - tél.: 01 40 69 53 16
Le radon dans les bâtiments Brochure disponible auprès des Fédérations Départementales du Bâtiment
Vidéo: " L'élimination des déchets de chantier - les initiatives des entreprises SECOGEST Audiovisuel - 7-9 rue La Pérouse - 75116 Paris - tél.: 01 40 69 52 96
Equipements techniques du bâtiment et acoustique Union Climatique de France - 7-9 rue La Pérouse - 75784 Paris cedex 16 - tél.: 01 40 69 52 94 Fédération Française de l'Équipement Electrique - 5 rue Hamelin - 75116 Paris tél.: 0144 05 84 00
La récupération des CFC SEDIT - Domaine de Saint-Paul -78470 St Rémy lès Chevreuse - tél.: 01 30 85 20 10
Guide des bonnes pratiques de la filière construction pour une meilleure prise en compte de l'environnement Fédération Française du Bâtiment - 33 avenue Kléber - 75784 Paris cedex 16 tél. :01 40 69 52 67
Manuel d'application des réalisateurs pour une meilleure prise en compte de l'environnement Fédération Française du Bâtiment - 33 avenue Kléber - 75784 Paris cedex 16 tél. :01 40 69 52 67
![]()